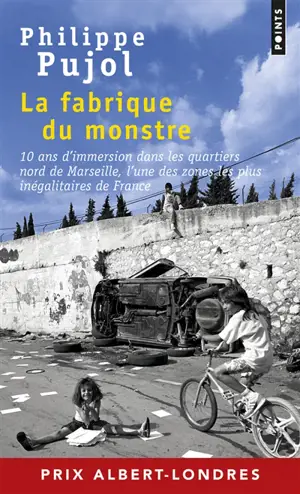Pourquoi est-il difficile de comprendre nos jeunes? Pourquoi peine-t-on à communiquer avec eux? Pourquoi assiste-t-on, complètement dans l’impuissance, au spectacle de leur désespoir ?
Triste est notre sort! De nos jours, la jeunesse algérienne, dans son écrasante majorité, vit un malaise sans nom. Elle ne respire qu’à peine. Ne rêve presque plus. Ne se projette pas dans l’avenir. Elle ne pense au meilleur que dans l’ailleurs. Elle est dans une expectative incertaine, aux horizons bouchés.
Si elle ne prie pas pour qu’un quelconque visa tombe du ciel, c’est à un « bôté » qu’elle pense. Tout le temps, sans répit, avec entêtement. Un bôté qui va creuser les flots, en partance vers le monde de ses illusions, ses fausses illusions. Mais imaginons, juste un instant, un bôté qu’un jeune achète peut-être au prix de durs emprunts ou de longues économies pour fuir ce qu’il considère comme enfer et qui finit noyé en haute mer. Voilà le désastre et il y en a tout un tas, hélas! L’enfer pour un jeune algérien, c’est de cesser de rêver et d’espérer. C’est d’être face au néant du sous-emploi et du mal-logement.
C’est de survivre au lieu de vivre, avec toute la considération des siens, de son entourage. C’est de penser en soi-même n’être qu’une charge, un fardeau, un moins-que-rien pour les autres et toute la société. L’enfer, pour lui, c’est d’être forcé à se conformer à un monde sourd qui lui tourne le dos, qui le rejette, qui le marginalise, qui le méprise. Tout se joue dans les neurones ma foi!
Dans le regard qu’on jette sur le jeune dans la cité, dans le quartier, dans la village ou la ville. Dans la place qu’on lui réserve dans le champ social, culturel et politique. La jeunesse algérienne, mal comprise, est en quête de soi dans un gros brouillard. Et il ne suffit pas de lui promettre argent et privilèges pour l’attirer ; la fixer au bercail, mais lui vouer du respect, lui redonner de la dignité et montrer de l’attention à son égard, de la compréhension.
Et puis, il va falloir se rendre à l’évidence que la volonté de s’envoler par ses propres ailes, de découvrir le monde, de faire s’effondrer la citadelle des tabous qui la menace d’autodestruction personnelle et de mort lente, est ancrée dans son logiciel.
Bref, beaucoup de facteurs doivent être étudiés et analysés pour comprendre le psychisme d’un jeune algérien. Sous d’autres cieux, on fait périodiquement des sondages d’opinion pour aller au fond des plaies sociales. Et l’on s’interroge pourquoi ce n’est pas le cas chez nous. Nos élites, nos chercheurs, nos lumières doivent se pencher en urgence, et loin de tout chauvinisme, sur les raisons de ce défaitisme, de ce désespoir, de cette saignée effrénée vers d’autres horizons, d’une jeunesse, la nôtre, en perte de repères.
Il est grand temps de tirer des conclusions utiles de ce phénomène inquiétant qui menace la société, dans ce qu’elle a de plus cher : sa cohésion. Cela est d’autant plus grave que l’individualisme a pris des proportions alarmantes au sein même des familles et du tissu communautaire des villages, capitalisme marchand oblige. Notre société peine à trouver sa voie, son véritable équilibre dans un monde de plus en plus gagné par la technologie, le parasitage du numérique et de l’internet.
Ainsi constate-t-on que nos jeunes copient des modèles virtuels qui « colonisent » leurs esprits et leur miroitent un univers édénique, fait de fric, de distraction et de plaisirs de toutes sortes. L’inhibition intra-muros due au dogmatisme religieux en vogue avec ses métastases collatérales : l’hypocrisie et la corruption spirituelle, l’immobilisme politique et les perspectives en berne en matière d’emploi, dans un cadre général caractérisé par une sensation de marasme, ont tiré vers le bas les volontés des plus récalcitrants des optimistes.
Ce qui a détruit par ricochet les valeurs de l’entraide, de la fraternité et de la solidarité, typiques de la société de la paysannerie traditionnelle d’autrefois. On ne se parle plus au sein de nos familles ; on n’y communique plus ; on n’y entretient plus, comme avant, les liens filiaux, de sorte à ce qu’on sauvegarde l’esprit sacré d’union et de collégialité. Ce qui a pour fâcheuse répercussion une certaine agonie des consciences. Vu de l’extérieur, ce phénomène n’est autre que la résultante logique de l’aspect sauvage de la modernité. De l’intérieur, cela dénote de la faiblesse , sinon de l’échec des relais traditionnels : famille, parents et proches, dans la transmission des valeurs ancestrales aux générations montantes. Autrement dit, il s’agit d’un conflit générationnel, à la fois incontournable et nécessaire, dans tout le processus développemental de n’importe quelle société…
Mais revenons au vif du sujet : qu’est-ce qui manque, par exemple, à un jeune algérien chez lui, pour qu’il ose prendre une patera à ses risques et périls, laissant derrière lui famille et proches dans l’incertitude, pour aller dans un autre pays où sa réussite reste pourtant hypothétique? Peut-être dirions-nous qu’il y a l’aspect économique qui prime et qui fait en sorte que, démoralisés par les perspectives sombres du monde travail, les jeunes préfèrent prendre la tangente.
Mais force est de constater que cette grille de lecture est quelquefois fausse. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on voit que par les temps qui courent, ce sont des jeunes cadres, parfois en bonne situation, qui préfèrent s’exiler, quitte à emprunter la voie de l’immigration clandestine. Le malaise est donc multiforme. Et il ne serait pas du tout rare qu’on se retrouve face à des cas de figure qui appellent à un profond diagnostic psycho-social.
En Algérie d’avant la parenthèse historique du Hirak, les jeunes se disaient écrasés sous les contraintes de l’autoritarisme avec sa tendance mafio-démagogico-rentière. La chape de plomb qui tombait sur eux était telle que, tout espoir du salut n’aurait été possible que par la chute de la dictature bouteflikienne. L’accumulation des frustrations collectives conjuguée au reliquat empoisonné de la guerre civile et à l’effet de la colère contenue pendant deux longues décennies ont débouché sur un raz-de-marée populaire d’une ampleur jusque-là inédite dans l’histoire contemporaine de l’Algérie.
L’aspiration à un Day-after démocratique, libre et prospère était forte. Les jeunes, dans leur ensemble, s’attendaient à une Algérie rayonnante, ensoleillée, jouissant d’une démocratie pionnière dans tout le bassin méditerranéen. C’était un rêve légitime à vrai dire, mais tout autant utopique, dans la mesure où, la spontanéité du mouvement populaire avait, en quelque sorte, plongé les masses dans un sentimentalisme passionné, frisant la cécité. S’il y a, au début cohérence dans les slogans portés pendant les manifestations, au fur et à mesure que le temps passe, les divergences idéologiques, résidus insolvables des déchirements du mouvement national du XXe siècle, ont flotté à l’horizon et on sentait que les foules ont commencé à s’épuiser d’une situation gaguesque qui perdure, sans qu’elle ne donne concrètement de fruits pour la jeunesse.
Ce climat confus, clivant, anxiogène, contradictoire a eu pour conséquence l’essoufflement de la revendication populaire sur fond de l’apparition de la pandémie de Corona. Après la fièvre du Hirak, le train révolutionnaire a été comme fourvoyé, prenant un sérieux coup de vieux. Le processus révolutionnaire aurait irrémédiablement tourné à des guéguerres intestines.
Et puis, la question des détenus d’opinion n’a pas été du tout du goût d’une population assoiffée de libertés et de démocratie. Exaspérés, les jeunes ont compris que le chemin pour le sacre démocratique est encore plus long qu’il n’y paraît. L’Algérie nouvelle promise d’en haut et à laquelle rêvaient ceux d’en bas semble hors de portée.
Malgré quelques timides réformes, notamment dans la lutte contre l’hydre de la corruption, des pratiques obsolètes héritées de l’ancien système ont fait leur retour et la lenteur du passage à une économie diversifiée, créatrice d’emploi et de richesses, a compliqué le New Deal algérien.
La bureaucratie est devenue la voiture-balai d’un engrenage administratif complexe, aux relents putrides. La courroie de transmission qu’espérait la jeunesse entre la base et la pyramide du système social a été comme coupée et la crise enlise le pays dans des polémiques stériles qui n’en finissent pas. Ce décor rabat-joie a été, d’une certaine manière, l’unique spectacle qui saute aux yeux.
Et la victime expiatoire dans tout ça : le jeune. Or, ce dernier ne demande qu’une seule et unique chose : respirer. Que signifie ce mot? Cela veut dire tout bonnement avoir la possibilité de rêver d’un avenir meilleur chez soi, avec les siens, dans la dignité. De parler, de créer, d’innover librement. De vivre tout court..
Kamal Guerroua