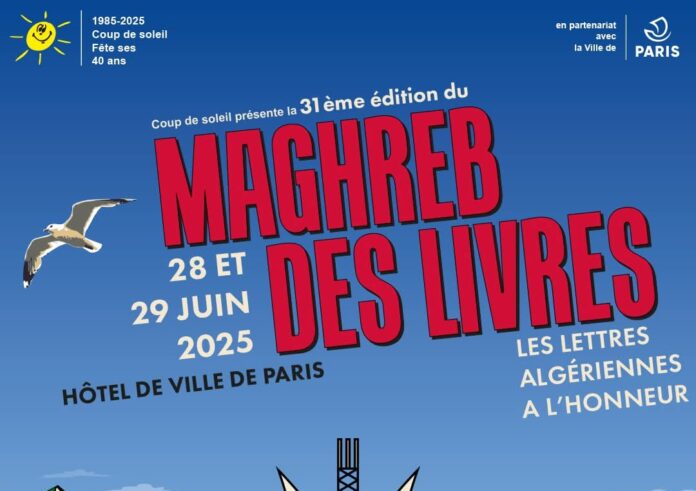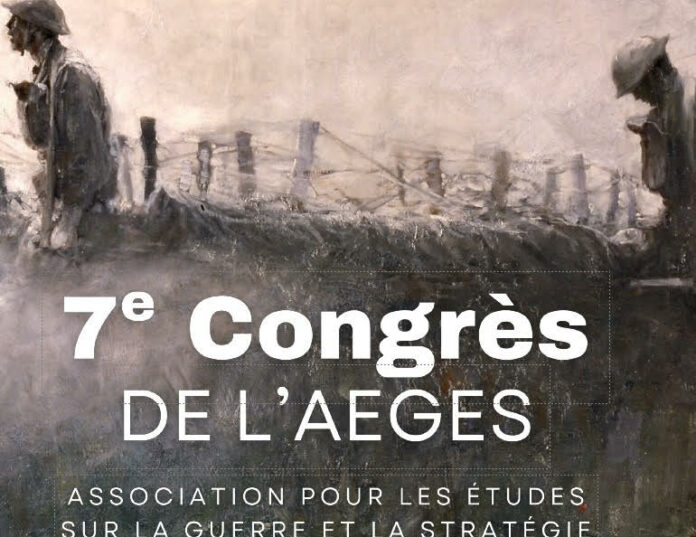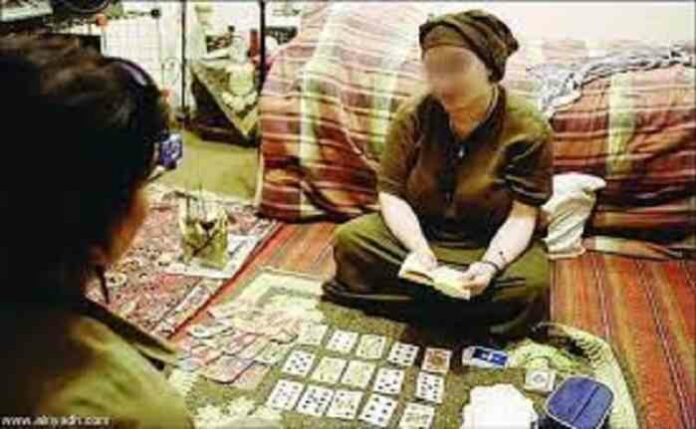Pour la première fois, le Parquet national antiterroriste s’est saisi d’un homicide en lien avec cette idéologie. Si la menace n’est pas nouvelle, elle s’est accrue depuis les attentats de 2015.
Il avait annoncé son intention de tuer des personnes d’origine maghrébine et de confession musulmane dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Le principal suspect du meurtre d’Hichem Miraoui, un Tunisien de 46 ans, à Puget-sur-Argens (Var), est entendu par les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) mardi 3 juin. « Moi, il n’y a pas d’allégeance à Al-Qaïda ou quoi que ce soit. Moi, c’est l’inverse, c’est l’allégeance au bleu-blanc-rouge », avait notamment déclaré Christophe B., 53 ans, avant de passer l’acte, appelant « les Français » à aller « les chercher là où ils sont ». Autant d’éléments qui ont conduit le Parquet national antiterroriste (Pnat) à considérer ces faits comme un possible attentat et à ouvrir une enquête pour assassinat et tentative d’assassinat terroriste.
C’est la première fois que le Parquet national antiterroriste se saisit dans une affaire d’homicide lié à l’extrême droite. La menace n’est pourtant pas nouvelle. Depuis sa création en 2019, le Pnat affirme avoir ouvert seize procédures en lien avec la mouvance d’ultradroite. Les autorités étaient parvenues jusque-là à intervenir avant le passage à l’acte. Christophe B., lui, n’était pas connu des services de renseignements. Etait-il un « loup solitaire », rattaché à des groupuscules ou téléguidé par une idéologie diffusée en ligne ? L’enquête devra le déterminer.
Des individus radicalisés en ligne
« Ces personnes vont beaucoup sur les réseaux sociaux et sont donc imprégnées des discours identitaires liés à la ‘remigration’ et à la thèse du ‘grand remplacement’ portée par l’écrivain Renaud Camus [une théorie complotiste sur la prétendue substitution des populations européennes par des immigrés non européens] », analyse le chercheur indépendant Jacques Leclercq, spécialiste de l’extrême droite et auteur du livre La menace de l’ultra-droite en France. Christophe B. partageait depuis plusieurs années sur Facebook ses commentaires haineux contre la communauté musulmane et les étrangers.
« Les réseaux sociaux constituent la fabrique des nouveaux ‘loups solitaires’ [de l’ultradroite]. Ces personnes finissent par considérer que l’immigration est un problème et passent à l’acte » explique Jacques Leclercq, spécialiste de l’extrême droite à franceinfo
Selon cet expert, « l’ultradroite est un terme un peu générique et pratique pour faire simple, mais qui recouvre plusieurs réalités ».
Nationalistes, révolutionnaristes, néonazis, conspirationnistes, suprémacistes… Dans une interview au Point(Nouvelle fenêtre), la directrice de la DGSI, Céline Berthon, affirmait en janvier que ses services portaient « une attention particulière aux thèses accélérationnistes [selon lesquelles il faudrait accélérer la survenue d’une guerre raciale avant qu’il ne soit trop tard pour l’emporter] et à la tendance de certains individus à vouloir s’armer ». Un pistolet, un fusil à pompe et une arme de poing ont été retrouvés dans le véhicule du suspect de Puget-sur-Argens.
Les groupuscules ou les mouvements d’ultradroite ont leur propre mécanisme de fonctionnement. Composés de quelques personnes, ils ont une structure proche de l’organisation militaire, plutôt hiérarchisée, selon les informations de franceinfo. Mais souvent lorsqu’un leader émerge, le groupe se scinde. En cela, ils diffèrent des organisations jihadistes, malgré un mimétisme dans les symboles : vidéo d’allégeance, volonté de mourir en martyr et fascination pour la violence.
Un climat favorable
Selon Jacques Leclercq, « la violence de l’ultradroite est un continuum depuis les années 1970, avec des périodes plus ou moins fastes ». Plus récemment, l’année 2015 « a constitué un tournant avec la survenance d’attentats terroristes sans précédent sur le sol européen et l’exposition de notre continent à d’importants flux migratoires », analysait l’ancien directeur de la DGSI, Nicolas Lerner, en juillet 2023, dans Le Monde(Nouvelle fenêtre). Après les attentats, une partie des militants du groupe Action des forces opérationnelles (AFO), par exemple, ont « commencé à se dire que parler, ça ne suffit pas, qu’il faut agir », d’après l’historien Nicolas Lebourg, interrogé par dans « Complément d’enquête ».
La pandémie mondiale de Covid-19 a ensuite été le catalyseur, pour l’ultradroite, de sentiments de haine, avec l’émergence de « profils d’un genre nouveau, complotistes ou conspirationnistes », poursuivait l’ex-patron du renseignement dans Le Monde. Nicolas Lerner citait également « la radicalité de certains discours politiques extrêmes ».
« Il est clair que la vie politique de notre pays peut avoir une influence sur la propension de certains à passer à l’acte. » Analyse Nicolas Lerner, ancien directeur de la DGSI dans « Le Monde »
« Ce n’est pas vraiment une nouveauté, mais ce qui change, c’est la caisse de résonance, abonde Jacques Leclecq. Aujourd’hui le climat est délétère et tout est mélangé : la haine du voisin, la religion… »
Les dissolutions inefficaces
Pour lutter contre ce phénomène et sa résurgence, les autorités procèdent régulièrement, depuis deux ans, à la dissolution de groupuscules, comme la Division Martel en novembre 2023, l’emblématique GUD (Groupe union défense) quelques mois plus tard, ou encore Lyon populaire en mai. Mais les têtes coupées repoussent. Quatre ans après la dissolution du groupe Génération identitaire, connu pour des actions contre les immigrés et contre l’islam, une autre organisation, les Natifs, revendique son héritage.
Treize de ses membres sont d’ailleurs jugés mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris pour la banderole raciste visant la chanteuse Aya Nakamura lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Le langage des Natifs est encore « plus radical que celui qu’utilisait Génération identitaire », pointe Jean-Yves Camus, spécialiste de l’extrême droite, auprès de l’AFP. Le politologue alerte sur « une fraction de la jeunesse qui vit dans un univers où la guerre civile est proche. Et cette guerre civile est en fait une guerre ethnique ».
Une tendance à la hausse
La situation de l’ultradroite en France s’inscrit dans un « contexte international où l’extrême droite et sa frange ultra ont le vent en poupe », écrit Jacques Leclercq dans son livre. Lors de son audition, suivie par Mediapart(Nouvelle fenêtre), au premier procès des quatre néonazis du « Projet WaffenKraft », condamnés pour avoir préparé des attaques terroristes, le chef de la sous-direction judiciaire de DGSI avait brossé le tableau d’une « nébuleuse mondiale ». L’ultradroite est « perçue comme la menace numéro un dans certaines démocraties occidentales, notamment anglo-saxonnes », avait-il relevé, soulignant que la France n’était « pas à l’abri ».
Un an plus tard, le directeur adjoint du Centre de recherche sur l’extrémisme de l’université d’Oslo expliquait, dans une tribune au Monde, que l’Hexagone était l’un des rares pays d’Europe occidentale où le terrorisme et la violence d’extrême droite s’intensifiaient.
D’après un rapport relayé par la Fondation Jean-Jaurès, l’Allemagne, avec un nombre élevé d’attaques terroristes d’extrême droite par rapport à ses voisins européens, continue de se distinguer. Mais la tendance n’est pas à la hausse outre-Rhin, contrairement à la France et au Portugal, qui ont connu une légère augmentation en 2022. Ce contexte oblige les autorités françaises à redoubler de vigilance. Et à accorder une surveillance particulière aux militants d’ultradroite pour tenter de repérer ceux qui sont susceptibles de passer à l’acte.
Francetvinfos