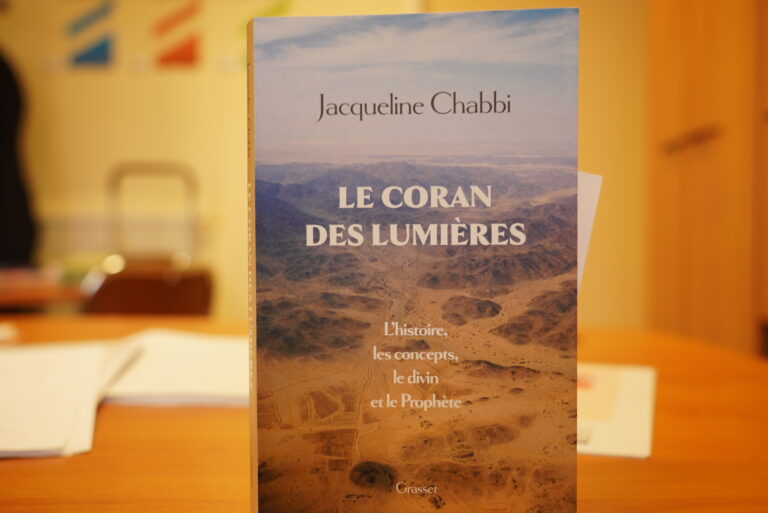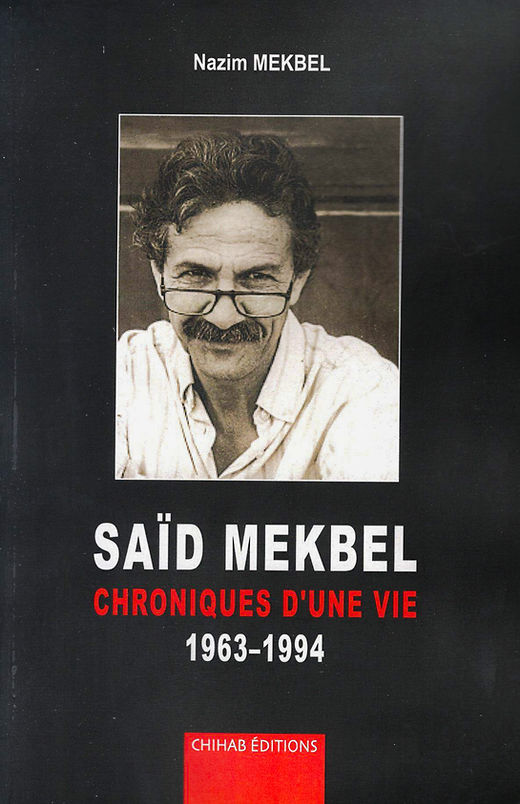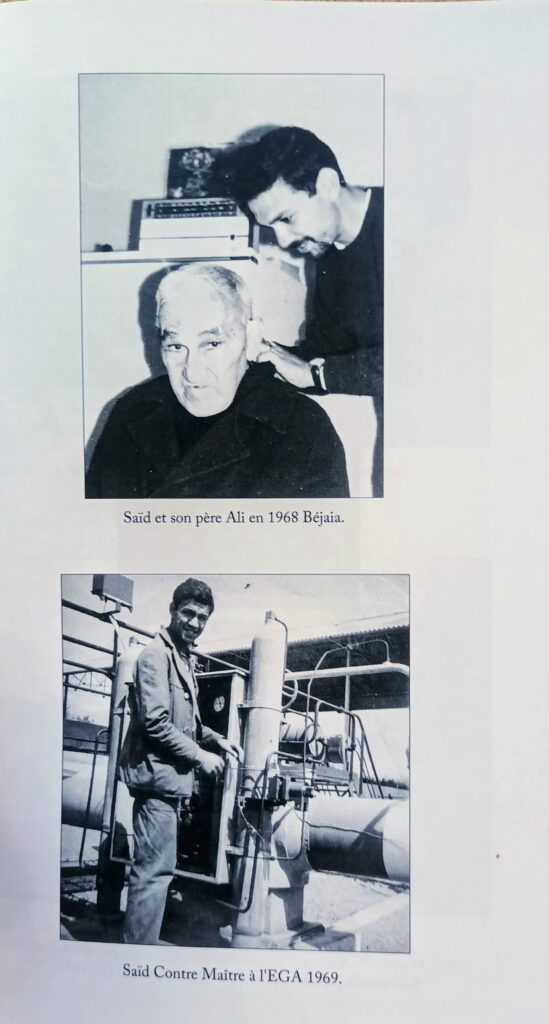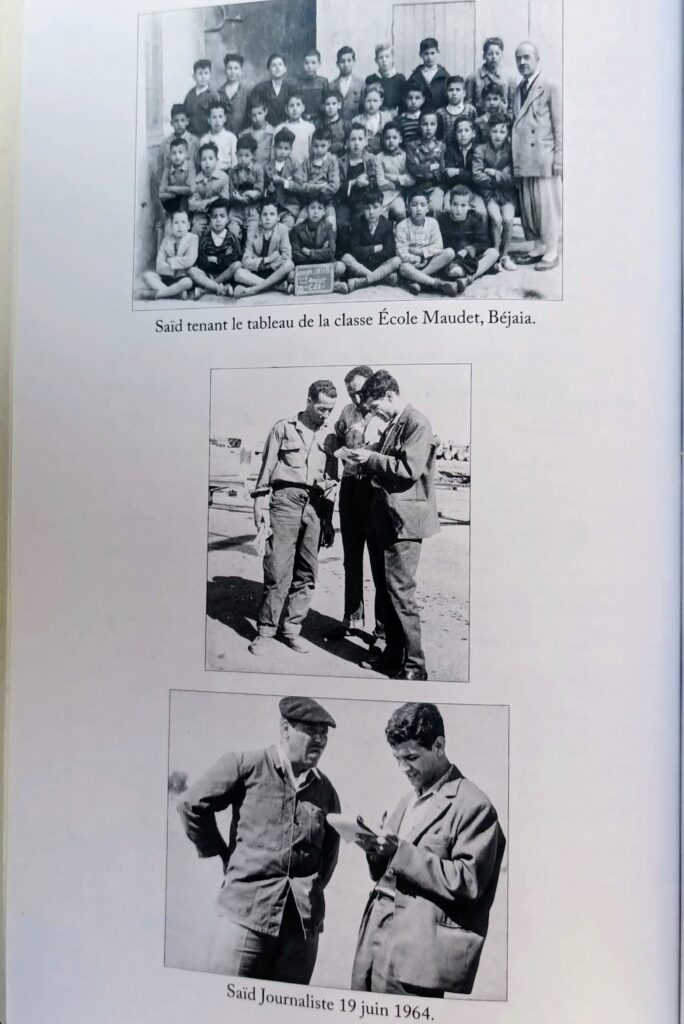Le Coran des Lumières. L’histoire, les concepts, le divin et le Prophète est un essai dans lequel JacquelineChabbi, historienne, arabiste et professeur honoraire, propose une lecture renouvelée du texte coranique. Elle y décortique des mots et concepts, les contextualise et leur donne leur sens historique.
« Etudier historiquement un texte ou un discours c’est chercher à comprendre ce qu’il signifie ou a signifié pour les hommes d’une société donnée, en un temps donné. Une telle recherche doit nécessairement être circonscrite. Il ne serait ainsi pas possible de traiter la question de savoir ce que signifie le Coran pour les musulmans : les musulmans certes mais de quel pays, de quelle société et de quelle époque ? (…) », analyse Jacqueline Chabbi.
L’auteure, reconnue pour ses travaux sur l’islam et ses origines, invite le lecteur à dépasser les idées reçues pour comprendre le Coran dans son contexte historique et culturel plutôt que de l’aborder uniquement comme un texte religieux figé. Elle propose une plongée éclairante au cœur du texte coranique, loin des lectures figées ou purement religieuses
Contrairement à d’autres écrits sacrés, le Coran ne se présente pas comme une narration linéaire : il est constitué de fragments variés qui se répètent, se reformulent et parfois se contredisent. Chabbi montre que pour en saisir le sens profond, il est essentiel de replacer ces fragments dans la grande Histoire, celle de la fin du VIIᵉ siècle, alors que l’empire arabe naissant cherche à affirmer sa place face à l’empire byzantin chrétien.
e Coran apparaît ici comme un ensemble de fragments, de répétitions et de reformulations, façonnés par le contexte de la fin du VIIᵉ siècle. Jacqueline Chabbi montre que ces paroles s’inscrivent dans un moment clé : celui de l’émergence du pouvoir arabe, face notamment au christianisme byzantin dominant. Comprendre le Coran, selon elle, suppose donc de le replacer dans ce paysage politique, religieux et culturel en pleine transformation.
L’auteure souligne notamment le rôle symbolique du Dôme du Rocher à Jérusalem, où des versets coraniques furent gravés très tôt. Ces inscriptions traduisent la volonté d’affirmer une nouvelle vision du divin et du message prophétique, dans laquelle Muhammad est présenté comme le continuateur de Jésus, tout en rejetant la Trinité chrétienne. Ce qui illustre selon Chabbi la dimension politique et symbolique de l’écriture coranique
Le Coran devient alors à la fois un texte spirituel et un instrument d’affirmation collective. Des sourates furent inscrites comme des samizdats sur ses murs, illustrant la volonté de faire du Coran un texte public, politique et religieux à la fois. Muhammad y est présenté comme successeur de Jésus, rejetant toutefois la trinité chrétienne
Jacqueline Chabbi ne se limite pas à une analyse historique : elle éclaire aussi les principaux concepts du Coran, comme les noms du divin, la figure du Prophète, ou encore des notions souvent mal interprétées dans les débats contemporains, comme le djihadisme ou des allusions à des phénomènes comme le Big Bang. Ce faisant, elle vise à déconstruire les contresens et les lectures idéologiques qui entourent trop souvent le texte. « Dans une société non-étatique, comme celle des tribus d’Arabie, la notion de djihad renvoyait au fait d’accepter de prendre un engagement ou de « faire effort » (le sens premier de ce mot » pour mener une action ou adopter un comportement. Ce dernier se retrouve d’ailleurs dans le djihad intérieur des mystiques qui font effort contre eux-mêmes pour vivre une foi intérieure plus intense », écrit l’auteure.
Accessible aux spécialistes comme aux lecteurs non habitués à l’histoire de l’Islam, Le Coran des Lumières se veut à la fois savante et vivante, offrant une approche critique fondée sur l’anthropologie historique et invitant à repenser ce que le Coran peut révéler lorsqu’on l’étudie en relation avec son époque et sa culture d’émergence.
Rabah Aït Abache
« Le Coran des lumières » de Jacqueline Chabbi. Éditions Grasset.