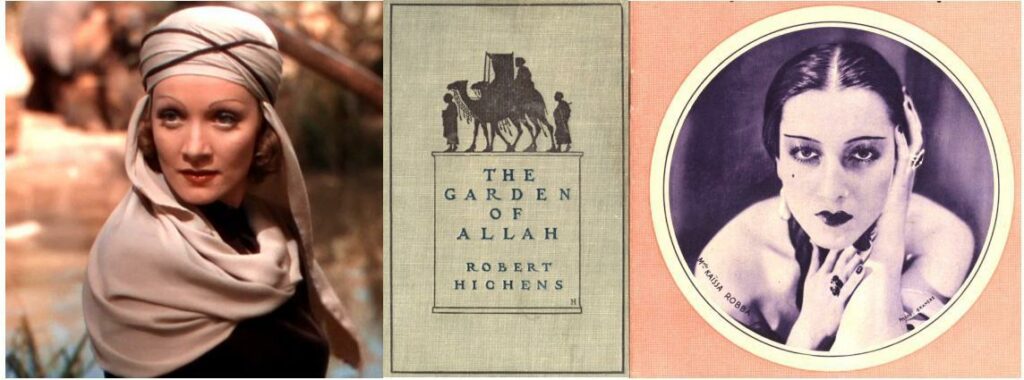Dans un monde où l’injustice et la censure cherchent à étouffer les voix, Hamma Meliani se dresse comme un dramaturge engagé, un passeur de mémoires et un poète révolté. À travers son théâtre, porté par l’urgence et la vérité, il donne vie aux tragédies contemporaines, de Gaza aux terres ravagées de Duel au lointain, enracinant son art dans les langues et les douleurs des peuples. Du tamazight à la dramaturgie grecque, il tisse un dialogue entre l’intime et l’universel, entre la résistance et la poésie, pour briser les murs du silence.
Dans cet entretien, Meliani dévoile sa vision d’un théâtre populaire, vibrant et subversif, qui refuse l’indifférence et célèbre l’espoir d’un renouveau humain, porté par la justice et la liberté.
Le Matin d’Algérie : En 2025, écrire sur Gaza, c’est écrire dans l’urgence. Avec L’Axe du monde, vous convoquez la tragédie antique pour évoquer un drame contemporain. Pourquoi ce détour par la Grèce des origines pour évoquer l’actualité la plus brûlante ?
Hamma Meliani : Oui, l’actualité est terrible. D’abord, je tiens à exprimer ma profonde tristesse et ma solidarité aux militantes et militants de la Flottille de la liberté, arraisonnés par Israël dans les eaux internationales. J’adresse également toute mon admiration et mes encouragements aux marcheuses et marcheurs du monde entier, ainsi qu’aux Algériens, Marocains et Tunisiens qui prouvent, par cet acte de résistance, la possibilité de l’unité du grand Maghreb. La menace est partout. Aujourd’hui, c’est l’enfer qui se déchaîne sur les Palestiniens, sous le regard impassible du monde.
Quelques jours après l’insurrection du 7 octobre 2023, dans un accès de colère, j’ai publié sur les réseaux sociaux un article d’alerte sur les crimes de guerre commis par l’armée d’occupation, article qui a été partagé et republié le 25 octobre 2023 dans les colonnes du journal national algérien L’Expression. Aussitôt après cette publication, ma colère n’a pas cessé. Je me suis alors mis en syntonie avec mes personnages en création pour trouver rapidement, en fonction de nos moyens et de nos possibilités, la forme dramaturgique et le langage théâtral idéaux pour exprimer ce drame.
Pourquoi la dramaturgie grecque des origines ? C’est pour donner vie à cette tragédie. Parce que le drame palestinien est une tragédie humaine qui nous bouleverse tous ; chaque jour, nous voyons le désastre que subit l’ensemble de la population palestinienne. C’est un fait historique qui me révolte. J’ai donc d’abord tenté d’aborder le sujet dans un oratorio, ainsi que dans un montage poétique en forme d’épopée, mais le temps manquait et il fallait agir vite. La dramaturgie grecque convenait parfaitement pour faire entendre et montrer la tragédie de la Palestine. C’est dans l’urgence que le Théâtre d’Urgence est né en novembre 2023 autour de L’Axe du monde, journal d’un génocide, une tragédie moderne, montée par des comédiens bénévoles et des militantes et militants d’Urgence Palestine.
Le Matin d’Algérie : Votre pièce est portée par un coryphée, figure rare aujourd’hui au théâtre. Que symbolise-t-il dans votre dramaturgie ? S’agit-il de la conscience d’un peuple, de la voix des absents ou de celle du poète ?
Hamma Meliani : En effet, le Coryphée de L’Axe du monde joue le rôle du narrateur qui fait le lien entre les individus en désarroi au sein de la société dans son ensemble. Il est tout à la fois la conscience humaine, la voix des vivants et des morts, et la rage du poète.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes l’un des rares dramaturges algériens à écrire en tamazight et à mettre en scène cette parole minorée. En 2025, quel espace reste-t-il pour cette parole, sur scène comme dans la société ?
Hamma Meliani : Tamazight est la langue de nos parents. C’est la langue de l’avenir. Je pense que la société algérienne dans son ensemble a pris conscience que notre identité nationale est foncièrement amazighe. Tous, dans toutes les régions d’Algérie, souhaitent la généralisation de l’enseignement du tamazight dans les écoles et les collèges du pays.
Le théâtre peut jouer un rôle d’unificateur auprès de ces nouvelles générations. Il peut les amener à s’exprimer en tamazight, en derja, en arabe ou en français. Toute langue est une richesse et le tamazight est l’âme et la voix de l’Algérie. Il faut rendre notre identité encore plus belle, à l’écoute du monde, éveillée, juste et rebelle. Quel espace reste-t-il pour le théâtre en tamazight ? Il y a certes un public et des créations qui, je l’espère, ne cesseront de se développer. Je ne connais pas la situation du théâtre en Algérie cette année, mais j’espère qu’il se développera.
Le Matin d’Algérie : Dans Duel au lointain, deux errants se confrontent dans un monde ravagé par les guerres et le chaos climatique. Cette pièce est-elle pour vous une fable sur l’humanité survivante ou une mise en garde ?
Hamma Meliani : C’est exact, c’est une fable, et comme toutes les fables, elle nous met en garde. Duel au lointain est une pièce drôle et dystopique dans laquelle une femme et un homme, fuyant le monde et errants dans l’immensité d’une terre ravagée, se rencontrent. Le climat est imprévisible et les rapports humains sont marqués par la suspicion et la violence. J’adore cette pièce. Je me suis beaucoup amusé à l’écrire en lui donnant des dialogues vifs et drôles qui mettent en valeur le traitement théâtral de ces deux personnages émouvants : une vieille femme au vocabulaire décalé et un vieux guérillero en fuite.
Je devais la monter avec mon ami Ahmed Benaïssa, mais il est décédé depuis. Il aimait l’échange de situations entre les deux personnages et voulait interpréter le vieux guérillero. Mais le temps était sans pitié, et un mois après, Ahmed Benaissa est décédé. Qu’il repose en paix. Par ailleurs, mon ami Hachimi Kachi a traduit la pièce en tamazight et, si les moyens le permettent, elle sera créée en 2026.
Le Matin d’Algérie : Vous écrivez depuis plus de quarante ans. Comment votre regard sur le théâtre et le monde a-t-il évolué depuis vos débuts dans les années 1980 jusqu’à aujourd’hui, où le sentiment d’effroi semble permanent ?
Hamma Meliani : En effet, c’est un monde où l’on se bat contre le temps perdu à se perdre, des décennies de bouleversements multiples qui nous font perdre la vision globale de la réalité, qu’elle soit festive ou morbide. Et qu’en est-il de mon regard sur le théâtre et la culture en général ? Le théâtre a perdu sa langue. Il a zappé sa fonction sociale, sa voix atone est inaudible et se perd dans les cris du monde. C’est l’inutilité du théâtre au théâtre.
Il est vrai que dans les années 80, les troupes étaient nombreuses et la parole était multiple. Les sujets abordés étaient tous ceux de la société, avec un langage théâtral aussi multiple que le nombre de troupes. C’étaient les idées progressistes de 68 qui continuaient d’irradier la créativité des artistes.
Après 1991, tout change dans les institutions culturelles et le politiquement correct sera exigé dans toutes les expressions artistiques. D’ailleurs, tout comme dans les médias qui semblaient auparavant animés par la soif d’éduquer, d’apporter la culture dans chaque foyer et d’informer, tout y a changé. Les médias sont devenus des organes de propagande et de désinformation.
Quelle est alors la portée de ma démarche artistique ? Mon théâtre est celui d’un dramaturge engagé. Et puis, être algérien et dramaturge engagé, c’est, aux oreilles des experts de la culture et des gardiens de la pensée unique, le son d’un bourdon de subversion. Oui, je mène un combat culturel et politique à travers mes créations théâtrales et mes publications. La censure étouffe nos voix ; elle se manifeste dans les commissions de lecture, l’attribution des subventions et les réseaux de diffusion. Il existe un écart scandaleux entre la population et les « sanctuaires de la culture » où l’art n’a plus de sens. Quelques théâtreux qui ont la jouissance de cet outil de travail ne conçoivent d’autres spectateurs qu’eux-mêmes et leurs amis. Ils admirent leur nombril dans leur théâtre impassible au rideau de roses, alors que le monde est en mouvement constant et que le génocide ronge l’âme de la Palestine. Il est temps de créer des œuvres qui parlent le langage d’aujourd’hui et véhiculent les idées, le génie et les espoirs des femmes et des hommes d’aujourd’hui.
Parfois, on a l’impression qu’une caste refuse de laisser la place aux artistes de la périphérie et aux créations nouvelles. Cette inutilité du théâtre est favorisée par la censure, le manque de contrôle des responsables de la culture et par le manque d’intérêt des élites à l’éducation et à la créativité des vivants. Le théâtre est un bien commun et sa parole nous manque. Les démarches artistiques portées par l’acte poétique sont le plus souvent mal interprétées, voire malvenues, dans les objectifs du développement culturel des communes et de l’État. Le marché de l’art, avec sa cour et son fric, nous inonde de sa culture du loisir éphémère. L’art facile et futile nous anesthésie chaque jour un peu plus.
Le Matin d’Algérie : Dans vos textes, la poésie est omniprésente. En 2025, alors que le langage est souvent réduit au flux des réseaux et au bruit médiatique, quelle est la place encore laissée à la poésie ?
Hamma Meliani : La poésie évolue avec les nouvelles expressions artistiques. Que peut encore la poésie ? Elle crie, elle interpelle, elle rassemble, elle se bat avec des mots. Certes, cela peut paraître insuffisant, mais les mots sont forts et percutants ; ils touchent le cœur et la raison des gens par leur vérité. Les mots combattent également les maux de la société.
La poésie libre ou subversive est partout autour de nous. Rien que sur le thème du génocide palestinien, d’innombrables poèmes et chants s’expriment dans toutes les langues sur les réseaux sociaux, faute de publication écrite. Il s’agit d’une poésie nouvelle, empreinte de colère et de compassion. Nos mots et nos images combattent les maux du mensonge et de l’intelligence conquérante, chacun le faisant à sa manière. C’est l’énergie du renouveau poétique, accessible à toutes et à tous, qui se développe en marge du marché de l’art et du show-biz pour faire entendre l’appel au secours de la Palestine. Que ce soit le rap, le slam, les clips vidéo ou toute autre forme d’expression, ces performances poétiques résolument tournées vers la libération de la Palestine pétillent d’intelligence et de vie. Si la poésie est une invite à célébrer la gloire du conquérant, elle exprime aussi le désarroi et l’impuissance de l’opprimé. Tout comme la folie, la poésie est l’une des ressources spirituelles de la révolte, de l’indignation, mais aussi de l’amour et de la justice. C’est une intuition, un songe, une colère humaine pour rester fidèle à sa rébellion.
Le Matin d’Algérie : En mettant en scène un couple palestinien, vous humanisez un conflit souvent déshumanisé. S’agit-il d’une manière de résister à l’effacement et à l’indifférence internationales ?
Hamma Meliani : Dans cette tragédie, le couple est la colonne vertébrale du peuple palestinien. Handal est un chrétien et Leila une musulmane. Tous deux attendent la naissance de leur enfant. Symbole d’un renouveau palestinien. C’est un couple comme les autres, avec des hauts et des bas, qui rêve de paix, de liberté et de justice véritable. Résistants acharnés contre la colonisation, ils entraînent compassion et colère dans leur sillage. Le Théâtre d’Urgence est un outil essentiel pour briser le mur de l’invisibilité et de l’indifférence internationale et sensibiliser les gens lors d’événements et de manifestations de solidarité avec la résistance palestinienne.
Le Matin d’Algérie : Vos œuvres parlent d’exil, de mémoire, de silence. À l’heure où les récits se fragmentent, comment votre théâtre parvient-il à recoudre ces mémoires disloquées ?
Hamma Meliani : C’est la magie du théâtre et de la poésie. Parfois dans le conte on évoque la mémoire, avec l’histoire on désigne le 17 octobre 61, en silence on exprime la vie de quartier et la violence policière. C’est difficile, cela dure depuis longtemps. Face à la censure exercée au sein de toutes les commissions culturelles qui étouffe nos voix, et à la désinformation médiatique qui fait de nous des caricatures atroces, nous résistons. Face à la malice des personnalités politiques qui se prennent pour la naïveté et les niaiseries des journalistes, des experts du théâtre et des inspecteurs de la culture, nous résistons. La hantise de la censure est toujours là, elle plane partout, surtout concernant l’édition.
Les éditeurs courageux sont mis à l’index, eux aussi craignent pour leur enseigne. Que reste-t-il à l’écrivain et au créateur ? Il lui reste sa colère et sa plume. Bien sûr, l’écriture en pâtit, c’est comme un corps qu’on ampute, mais elle s’améliore avec ruse, et la ruse parfois joue avec la censure, transforme le manuscrit, reprend avec hardiesse le sens profond des paroles interdites, tourne l’obstacle et prend le risque de n’agir que dans le seul intérêt de la vérité. Oui, il est compliqué de se faire éditer, mais il est également compliqué d’écrire ou de dire ce que l’on veut. Le contrôle social mène la cadence des pas, certains résistent, d’autres trébuchent ou restent dans les rangs de la masse. Il est difficile de s’exprimer librement et de porter sa parole pour être entendu partout. Et dans ce chaos mondial, nous ne devons pas rester sourds et muets face aux malheurs de l’injustice et aux crimes de guerre.
Le Matin d’Algérie : Vous avez longtemps milité pour un théâtre populaire, enraciné dans les langues et les douleurs du peuple. Ce théâtre a-t-il encore une place dans un monde dominé par l’image, l’instantané et le spectacle ?
Hamma Meliani : Je n’ai pas un optimisme débordant concernant la place du poète, de l’écrivain, de l’artiste en général. Aujourd’hui, rares sont les artistes soutenant les contestations contre l’occupation de la Palestine et le génocide qu’elle subit, avec leurs paroles, leurs écrits ou leurs médias.
Les lois relatives à l’apologie ou à l’antisémitisme hantent les artistes, qui ont peur de perdre leur emploi, leurs biens et leur famille. Les audacieux qui s’indignent et crient leur colère sont rares. Les artistes, comme toutes les personnalités publiques, sont muselés. Dans ce monde qui bride les gens et étouffe la parole de vérité, dans ce monde où l’intelligence artificielle et le numérique ont pris d’assaut la créativité humaine, il m’est difficile de prévoir quelle sera la place de l’artiste. Mais l’acte poétique, individuel ou collectif, continuera d’exister pour fustiger nos sociétés qui, fâcheusement, ont de moins en moins besoin de lire, de se cultiver, de connaître l’histoire. Nos sociétés consacrent de moins en moins de temps à l’actualité et aux bouleversements du monde. Franchement, ça va être difficile, mais il faut se battre.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes également un passeur entre les générations, les langues et les continents. Quel dialogue souhaitez-vous instaurer entre les jeunes artistes d’Algérie, de France et du reste du monde ?
Hamma Meliani : Un dialogue culturel est essentiel au bassin méditerranéen. Instaurer un dialogue en interaction avec tous les arts est un moyen plus qu’utile pour vaincre l’ignorance, l’exclusion et les discriminations dont souffrent nos villes et nos sociétés, et pour tisser les liens qui fondent la communauté humaine. Des actions pédagogiques sous forme de créations théâtrales, de formations pratiques et de conférences permettront la confrontation d’œuvres pour ouvrir le débat entre créations et créateurs, entre spectacle et public. Ces interactions artistiques sont essentielles dans le cadre de ce dialogue entre les pays.
Le Matin d’Algérie : La pièce L’Axe du monde est créée pendant la guerre, alors que Gaza est détruite et que la douleur palestinienne est souvent censurée. Pensez-vous que le théâtre peut encore briser ces murs du silence ?
Hamma Meliani : Le Théâtre d’urgence reste fidèle à sa révolte, à ses actions de soutien et de solidarité avec les Palestiniens ; il participe également à la lutte contre le mur du silence qui sépare l’humanité en deux mondes. Il est difficile de porter haut la parole de vérité devant la censure. C’est vrai aussi qu’autour de la création et de la diffusion de L’Axe du monde, journal d’un génocide, le théâtre d’urgence, malgré les obstacles, s’est manifesté en un acte poétique porté par des comédiens bénévoles et des militantes et militants d’Urgence Palestine. Dès novembre 2023, nous avons organisé des rencontres, des lectures publiques de la pièce, ainsi que des débats, avant de commencer, en décembre, à former une troupe et à initier l’essentiel de l’expression dramatique aux participants directement pendant les répétitions, pour enfin mettre en scène la pièce.
Depuis janvier 2024, le spectacle a tourné dans plusieurs villes de France, dont Paris, en banlieue et pendant le Festival d’Avignon. Vu et apprécié d’un grand public, il a permis d’ouvrir le débat et de sensibiliser les spectateurs à la tragédie du peuple palestinien. Je remercie ici tous les membres de la troupe pour leur courage, leur dévouement et leur engagement dans cet acte théâtral à contre-courant de la parole de l’establishment. Merci à mes ami(e)s d’avoir tenu bon, malgré les contraintes matérielles, professionnelles, étudiantes et familiales. Je remercie également les structures et organisations associatives qui ont soutenu et accueilli L’Axe du monde, Journal d’un génocide dans leurs villes. Je remercie également l’éditeur de cette œuvre pour son courage et son amitié. Édition Tangerine Nights 2024. L’Axe du monde de Hamma Meliani.
Le Matin d’Algérie : Les figures féminines de vos pièces – souvent fortes, blessées, résistantes – rappellent que vous n’écrivez pas seulement l’Histoire, mais l’intime. En quoi la femme est-elle représentée dans votre théâtre ?
Hamma Meliani : Elle représente R’guia, ma mère, elle représente Gaïa, notre mère à tous. Elle est la sœur rebelle, l’amoureuse éperdue qui se cherche. Elle incarne la justice, la tendresse.
Le Matin d’Algérie : Vous avez été membre de jurys, directeur de troupes, metteur en scène et formateur. Comment percevez-vous l’évolution des pratiques théâtrales aujourd’hui, notamment dans les zones de fracture comme les Aurès ?
Hamma Meliani : L’Aurès n’a jamais été une zone de fracture ; c’est le cœur de l’Algérie libre et indivisible. C’est une région en pleine mutation, avec une démographie en augmentation constante, où il est vrai que tout manque pour mieux vivre. Pourtant, l’Aurès connaît un engouement pour l’art en général ; des poètes, des artistes, des chanteurs de talent aimeraient aussi se produire dans les galeries d’art et sur les scènes des théâtres. Ce marasme est peut-être passager. Il est temps de mettre en chantier une politique culturelle nationale et une éducation harmonieuse pour la jeunesse de toutes les régions d’Algérie. Chaque région développera ses activités culturelles, ses structures, ses lieux, la qualité de la pratique artistique et ses liens avec les autres régions pour renforcer la cohésion nationale. Il en va de même pour les sciences et les activités sportives dans les Aurès et ailleurs. Il faut investir dans la jeunesse, ouvrir des gymnases, des stades, des écoles spécialisées, des théâtres, des bibliothèques, des médiathèques, etc. Notre peuple a besoin de respirer et de voir ses enfants s’épanouir dans la joie sociale.
Le Matin d’Algérie : Enfin, dans ce monde troublé, qu’est-ce qui vous pousse à écrire, à témoigner et à croire encore dans le pouvoir de la scène ?
Hamma Meliani : Je ne supporte pas l’injustice. Je lutte et je témoigne avec mon acte poétique. Free Palestine.
Entretien Réalisé par Djamal Guettala



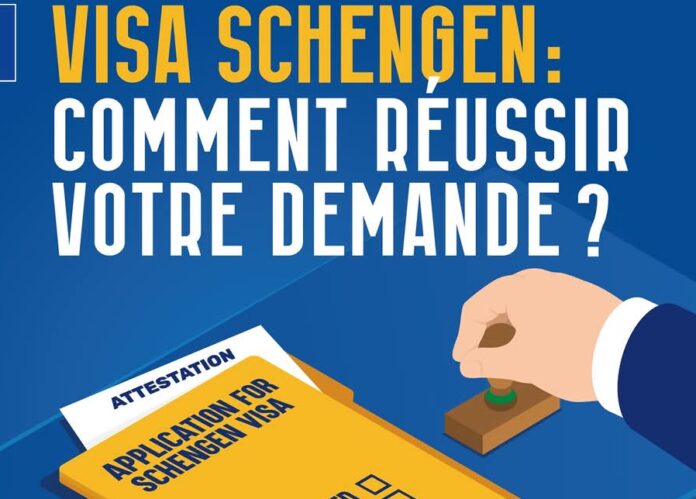







![- Le jardin d'Allah (1927) - [www.imdb.com] - Le jardin d'Allah (1927) - [www.imdb.com]](https://lematindalgerie.com/wp-content/uploads/2025/06/Le-jardin-dAllah-1927-www.imdb_.com_-e1749487942644-696x436.png)