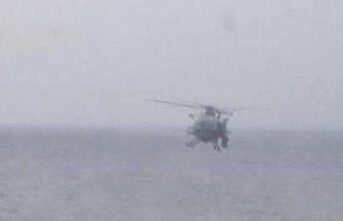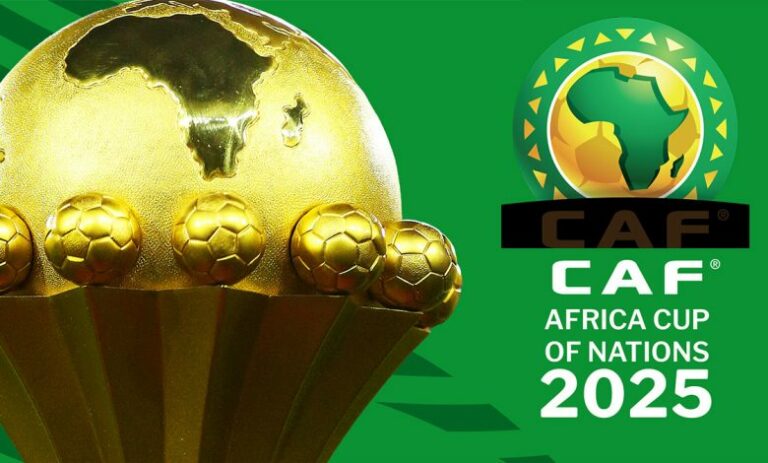Dans un contexte où la mémoire de la colonisation française en Algérie demeure un sujet de tensions, de silences et de controverses, Le Matin d’Algérie a réuni Sandrine Malika Charlemagne, réalisatrice et auteure franco-algérienne, et Jean Asselmeyer, réalisateur et documentariste, dans un entretien croisé. À partir de l’article publié dans La Croix et de leurs travaux respectifs, ils interrogent les violences coloniales, les mythes persistants, le rôle des témoignages, ainsi que la transmission de cette histoire aux jeunes générations.
Leur regard croisé offre une lecture plurielle d’un passé qui continue de peser sur les relations entre la France et l’Algérie.
À travers leurs expériences personnelles et artistiques, ils évoquent la manière dont la mémoire se construit, se transmet et se confronte aux silences institutionnels. Cet entretien met en lumière la nécessité d’un dialogue sincère et d’une réflexion approfondie pour comprendre et assumer l’histoire coloniale
Le Matin d’Algérie : Dans l’article de La Croix, vous insistez sur la nécessité de « ne pas tronquer la vérité » sur la colonisation. Quels événements ou pratiques restent, selon vous, encore trop méconnus du public français ?
Sandrine Malika Charlemagne : Une question assez méconnue est celle des essais nucléaires français qui ont eu lieu dans le Sahara dans les années 60 et de leurs conséquences néfastes encore aujourd’hui. La France pourrait par exemple envisager de nettoyer les zones contaminées par les radiations et les déchets nucléaires. En 2026, il serait temps.
Il y a aussi la question du trésor d’Alger en 1830. L’or découvert dans les caves de la Casbah. Cet or sera transféré à la Banque de France. Pierre Péan a consacré un ouvrage sur cette question, paru en 2004 chez Plon : Main basse sur Alger – conquête sur un pillage – Juillet 1830.
Et aussi, dans un autre registre, la figure d’Abd el-Kader. Il s’agit d’un personnage complexe, à cheval entre l’Orient et l’Occident. Il semblerait que le 18 juin 1864, Abd el-Kader al-Hassanî reçoit à Alexandrie l’initiation maçonnique par la Loge des Pyramides, pour le compte de la loge parisienne Henri IV. En outre, durant son exil en Syrie, il a protégé les chrétiens orientaux pendant une persécution.
Le Matin d’Algérie : Vous évoquez le silence de votre père sur son vécu en Algérie. Comment ce silence a-t-il influencé votre propre rapport à l’histoire coloniale ?
Sandrine Malika Charlemagne : Je n’avais jamais eu l’occasion d’aller en Algérie avec mon père, mort relativement jeune, à 49 ans. J’irai pour la première fois en 1999. J’étais à Sidi Bou Saïd, en Tunisie, chez une amie réalisatrice qui devait se rendre au Festival de Tébessa présenter son film. Elle me proposa de l’accompagner.
Là-bas, je me suis liée d’amitié avec Ahmed Benaïssa, qui, à cette période, dirigeait le Théâtre de Sidi-Bel-Abbès. Nous avons passé de longs moments à discuter, il me parla notamment de la façon dont il essayait de continuer à faire du théâtre malgré la situation très compliquée de l’époque. Mais aussi du passé colonial de l’Algérie. En 2000, je me rendais de nouveau en Algérie pour coordonner un festival lié aux écritures contemporaines, guidée dans mes recherches par Ahmed Benaïssa. Ce festival se déroula ensuite à Montpellier en partenariat avec le CDN des Treize Vents.
Suite à ces différents séjours, j’écrivis plus tard Mon pays étranger, publié aux Éditions de La Différence, où la narratrice part en quête de ses racines. Mais il s’agissait surtout d’une rencontre avec le peuple algérien, le monde du théâtre et celui du journalisme. Avant de rencontrer Ahmed Benaïssa, j’avais lu quelques ouvrages mais très peu en réalité et vu La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo et Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier.
Je pense que le silence de mon père a déclenché quelque chose d’assez inexplicable, comme une part manquante, qu’on essaie ensuite de combler. C’est sans doute de cette recherche qu’est venu mon désir de mieux connaître le passé colonial en Algérie.
Le Matin d’Algérie : La mémoire des massacres, comme celui des Ouled Riah en 1845, est rarement évoquée. Pourquoi est-il crucial de rappeler ces épisodes aujourd’hui ?
Sandrine Malika Charlemagne : Parce que ces épisodes sont en réalité très méconnus en Occident et qu’il est nécessaire de les rappeler afin de mieux appréhender une certaine vérité.
Le Matin d’Algérie : Vous critiquez l’idée que la colonisation française en Algérie ait été un « projet de modernisation ». Quels sont, selon vous, les principaux mythes à déconstruire ?
Jean Asselmeyer : Tout d’abord il faut constater que ce projet est un projet imposé à un peuple qui n’a rien demandé. Concrètement, une force militaire met en place par la force une colonie de peuplement c’est-à-dire une démarche de remplacement d’un peuple par un autre.
Dans cette première phase qui va de 1830 au début du XXe siècle on peut affirmer, comme le font certains universitaires, tel Olivier Le Cour Grandmaison, que coloniser revient à exterminer. Ce que revendiquent fièrement eux-mêmes les auteurs de massacres, enfumades, viols et autres barbaries dans de nombreux écrits et mémoires comme ceux du maréchal Bugeaud, et autres Pélissier et Lamoricière.
Comment donc qualifier sinon de barbares ceux-là mêmes qui prétendaient apporter leur civilisation et ces prétendus bienfaits en l’imposant par la force brutale. Je me contenterai de cette remarque liminaire pour commencer à démystifier ce qui en découle que ce soit dans le domaine économique, des transports, de la santé, de la culture.
Le Matin d’Algérie : Dans votre expérience, que révèlent les témoignages de ceux qui ont vécu le colonialisme, comme Gilberte et William Sportisse, que les livres d’histoire ne transmettent pas ?
Jean Asselmeyer : Dans notre film, il y a des témoins directs qui relatent ce qu’ils ont vécu de l’intérieur, mais aussi des historiens dont la démarche s’appuie sur des sources écrites ou archives. Les deux démarches contribuent à la quête de la vérité. Dans le cas de Gilberte et William Sportisse dans notre film, ils s’expriment avant tout comme témoins. C’est leur vécu qu’ils relatent et l’on peut affirmer que la petite histoire rejoint la grande Histoire.
Premièrement par la durée de leurs témoignages qui englobent une période de près de 80 ans de la fin des années 30 à 2020. Deuxièmement sur le plan factuel, leur récit nous permet de découvrir des aspects inédits de la lutte du parti communiste algérien en particulier sur sa participation à la lutte armée.
Les témoignages de William et Gilberte rejoignent ceux de Zoheir Bessah, directeur d’Alger républicain, et de Sadek Hadjeres, également cadre dirigeant du parti communiste algérien. Quasi inédit également, il faut noter le témoignage de William appelé aux armées en 1940 dans une unité spéciale réservée aux juifs et le caractère discriminatoire de ces unités.
Mise à part ces aspects factuels, il faut remarquer l’humanité des deux protagonistes qui contribue à la force de leurs témoignages, la colère de William quand il évoque le 8 mai 1945 et les massacres de Sétif, Guelma et Constantine, et le dépassement par l’humour de Gilberte lorsqu’elle relate les tortures qu’elle a subies après le coup d’État du colonel Boumediene.
Le Matin d’Algérie : Comment les traces de la colonisation se manifestent-elles encore dans la société algérienne contemporaine, sur le plan social ou économique ?
Jean Asselmeyer : Mon regard sera toujours un regard extérieur, susceptible d’erreur bien entendu. Je me contenterai donc de généralités mais je pense que tant que le peuple algérien ne sera pas libéré lui-même du capitalisme à l’époque impérialiste il souffrira toujours de ce système hérité du colonialisme. Pour cela le peuple algérien comme tous les peuples du monde devrait pouvoir se reposer sur la solidarité internationale. C’est pourquoi il est vital aujourd’hui plus que jamais de dénoncer fermement ceux qui, dans les métropoles impérialistes, nostalgiques de cette période coloniale, veulent dicter leur loi et imposer leurs intérêts à un peuple souverain.
Le Matin d’Algérie : La reconnaissance des crimes coloniaux est au centre de votre réflexion. Pensez-vous qu’elle soit possible sans un véritable travail de mémoire institutionnel en France ?
Sandrine Malika Charlemagne : Le travail de mémoire institutionnel en France est primordial mais n’est pas suffisant.
Il y a souvent de nombreux blocages, des commissions de réflexion qui commencent un travail puis qui s’interrompent et au bout du compte, ça n’avance guère. Aussi, je crois en une parole plus diversifiée, notamment provenant du monde artistique.
Le Matin d’Algérie : Votre identité franco-algérienne vous place entre deux perspectives historiques. Comment cette double appartenance nourrit-elle votre regard sur les relations bilatérales ?
Sandrine Malika Charlemagne : J’essaie de comprendre du mieux que je peux et de l’intérieur les positions de chacun. Cette double appartenance m’aide à identifier les non-dits, par exemple les massacres commis par les Français, tout en restant à l’écoute des avis divergents.
Le Matin d’Algérie : Vous soulignez l’exploitation économique et la spoliation des terres durant la colonisation. Selon vous, quels impacts sont encore visibles aujourd’hui ?
Jean Asselmeyer : Je peux difficilement répondre à cette question dont la réponse appartient aux Algériens d’Algérie.
Le Matin d’Algérie : Quel rôle peuvent jouer la littérature, le cinéma ou le documentaire pour transmettre cette mémoire à ceux qui ne l’ont pas vécue ?
Jean Asselmeyer : Pour tous les peuples du monde la priorité réside dans la liberté de création des artistes. Sans celle-ci il ne peut y avoir de transmission digne de ce nom.
Je dois hélas constater que notre film consacré à William et Gilberte Sportisse, coproduction franco-algérienne, n’a toujours pas reçu de réponse à sa demande de visa d’exploitation en Algérie, ceci un an après sa sortie en France. Ceci dit, il est évident que le cinéma de fiction et le documentaire sont de beaux instruments de rapprochement entre les êtres humains, au même titre que la poésie et la littérature.
Le Matin d’Algérie : Certains acteurs politiques ou intellectuels en France minimisent encore le passé colonial. Comment, selon vous, sensibiliser honnêtement l’opinion publique ?
Sandrine Malika Charlemagne : Peut-être avec des entretiens sur de grandes chaînes d’écoute réunissant des historiennes et historiens qui, même s’ils ont des points de vue différents, se retrouvent ensemble pour débattre. C’est dans le débat d’idées qu’aura des chances de naître une meilleure compréhension.
Le Matin d’Algérie : Enfin, quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations, en France et en Algérie, sur l’importance de connaître et d’assumer ce passé ?
Jean Asselmeyer : Paradoxalement je souhaiterais leur transmettre la force de cette jeunesse éternelle de Gilberte et William, force forgée dans la lutte pour un monde plus juste.Force porteuse d’un immense espoir malgré un monde qui semble aller à sa perte. Ce qui me paraît indispensable également, c’est l’idée exprimée par William et Gilberte que la lutte continue après l’indépendance, qui est une étape nécessaire mais pas suffisante.
Cette lutte pour une société plus juste ne peut se mener que de manière internationale, en liaison avec d’autres peuples, d’où le rappel par William de l’importance de la solidarité avec la lutte du peuple palestinien.
Entretien réalisé par Djamal Guettala