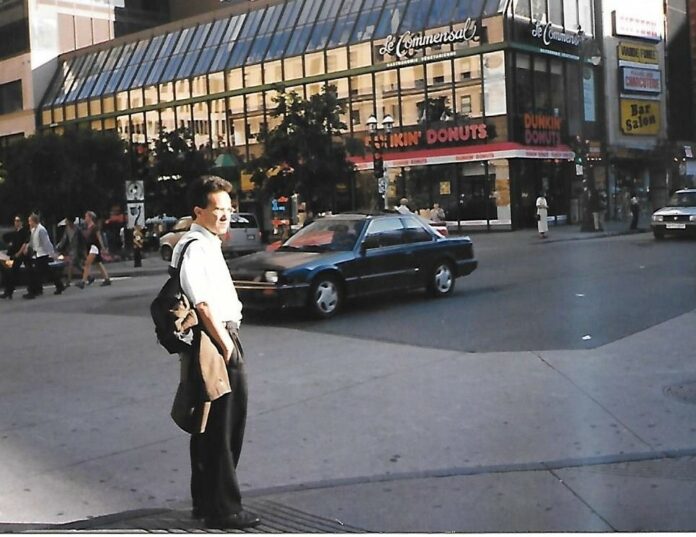Pour l’heure, ils s’amusaient. Ils se querellaient gentiment de temps à autre, ayant au fond conscience que la solidarité devait être de rigueur entre eux. Ils s’interrogeaient souvent sur leurs conditions d’existence et le peu de cas qu’ils représentaient pour leurs gouvernants.
Des discussions souvent passionnées avaient lieu avec les mots de tous les jours. Des mots simples pour tenter de percer les lourds secrets de la vie. L’été durant, ils se voyaient à leur quartier général, le cinéma Star, devenu depuis un centre commercial. La saugrenue décision ! Réduire la culture pour l’alimentation. Ils avaient faim de cinéma, même si c’est le rêve qui leur était servi.
Au moins, ils pouvaient échapper aux mensonges qui leur étaient serinés par ceux là même qui se sont prévalu d’une légitimé historique pour leur voler leurs destinées. Sans qu’ils aient eu la moindre occasion, en quelque lieu que ce soit, pour exprimer leurs doléances. Et, Dieu seul sait, qu’ils en avaient. Surtout en qualité de candidats à la vie adulte dans un pays libéré des contingences coloniales.
Souvent chez eux, ils se contentaient de pain avec des oranges, voire de la kesra avec du gazouz. Ils n’en faisaient aucun drame. Et pour cause, ils subissaient leur sort. Privés d’expression dès leur prime jeunesse, ils allaient mesurer davantage cette frustration. Il est vrai que lorsqu’on a peu conscience de son sort lié à la fois aux séquelles et des affres d’une guerre et à la politique menée en leurs noms par des dirigeants, on se sent moins brimé ; ils en connaissaient peu à l’époque, à part le mythique Ferhat Abbas et sa pharmacie. Il n’empêche qu’ils rigolaient bien de leurs petits malheurs. Qui se souciait alors de leur quête de savoir.
Aucune bibliothèque pour les accueillir l’été pour étancher cette soif. Leurs parents étant hélas souvent illettrés, voire même analphabètes, leurs consciences étaient livrées aux films spaghettis dont ils se demandaient toujours si le héros allait mourir à la fin et les films hindous dont ils se régalaient par les chants et danses. Quelle tristesse pourtant ! Quel gâchis à coup sûr !
Il est vrai que le pays sortait d’une guerre dévastatrice et en pleine reconstruction. Et, sans coup férir, des citoyens avisés et malins en diable avaient su investir les villas laissées vacantes.
Bradées à des prix défiant toute concurrence, lorsqu’elles étaient payées ; elles changèrent de propriétaires, ces nouveaux indus s’empressèrent de se faire établir des actes notariés. Et d’adopter la mentalité des anciens colons par leur comportement. Il se rappelle que le fils de l’un d’eux sortait une banane à la main comme pour les narguer. Et lorsqu’il daignait leur parler, c’était pour leur rappeler sentencieusement que son père -ou son oncle- était capitaine dans l’armée.
A l’indépendance, ce grade valait son pesant d’influence. Revenue des frontières où elle se trouvait, l’armée fut instrumentalisée pour servir, dit-on, de fer de lance à Ben Bella promu président de la République pour quelques mois. Pourtant, l’apolitisme devait être l’une des principales caractéristiques de l’armée, lui expliqua quelques années plus tard, Ameyar, l’un des voisins d’alors qu’il fut appelé à revoir à diverses occasions… Il était pour ainsi dire leur aîné en conscience…
De l’autre côté de la rue, chaque famille vivait dans des haras comme au quartier de Langare. Dans des chambrées tellement exiguës que l’on ne pouvait oser bouger. A peine la place pour un vieux lit en fer sur lequel folâtraient leurs parents. Eux, ils dormaient à même le sol. Comme on dit, la terre est rahma, miséricorde. C’est dans ces espaces que beaucoup de destins se jouèrent. Ceux de leurs pères d’abord dans les chantiers du bâtiment, les leurs ensuite sur les bancs de l’école qui leur promettait alors un avenir radieux…
Autant qu’il lui souvienne, son père a toujours été manœuvre à la quinzaine dans des chantiers de bâtiment, au service d’entrepreneurs français (il n’était pas le seul dans ce cas). Le nom de l’un d’eux est demeuré sympathiquement vivace dans sa mémoire (Girardi, sans doute d’origine corse ou italienne).
Il est vrai que dans les années 1960, sans doute sous l’impulsion de ce qui a été appelé alors le Plan de Constantine, Sétif était devenu le théâtre de constructions multiples sous forme d’immeubles à quatre ou cinq étages, style HLM. C’étaient des constructions fort sommaires, à l’architecture des plus dépouillées ; l’exiguïté immodérée le disputait à l’esthétique sans raffinement. Autant dire, des immeubles à caser le lumpen prolétariat évadé des campagnes des hauts plateaux sétifiens qui se vidèrent peu à peu de leur sève laborieuse au grand dam des autorités.
Il est vrai que l’agriculture devenait peu à peu le parent pauvre de l’économie, les soucis des planificateurs d’alors étaient ailleurs. De pays exportateur de grains, devenir importateur de sa pitance : telle fut leur triste besogne.
Aveuglés par leurs fantasmagories technocratiques à vouloir les mener presto illico au paradis industriel au prix d’un endettement devenu un casse tête depuis. Ces lubies leur coûtent encore à ce jour, quelques années après, un nœud de problèmes constituant un véritable goulot d’étranglement pour le pays. Mais qu’importe pour ces dirigeants habitués à commander un peuple aux ordres et domestiqué, l’absence de débat contradictoire étant alors au point culminant de la pensée unique. Ou dominante, selon les périodes…
Il se rappelle surtout du jour où la demande de son père d’un appartement type F2 a été acceptée, il est revenu au domicile d’alors situé à El Combatta avec la clé. Dans des immeubles où il fut manœuvre. Il a encore sous les yeux ses parents fébriles de joie indicible. La clé du paradis leur était confiée. Ils déménagèrent dans un nouveau quartier du côté d’El Djenane, dans le quatrième bâtiment près de Aïn Moreau, fontaine qui rendit maints services aux habitants car les coupures d’eau étaient monnaie courante.
Ils étaient des gamins, mais leurs parents les envoyaient souvent jouer les cosettes pour stocker le précieux liquide pour les besoins quotidiens ; d’où la possession de divers ustensiles allant du sceau au jerrican dans chaque famille. Inutile d’insister sur les cohues matinales donnant souvent lieu à des querelles se terminant parfois par un pugilat au bénéfice du plus musclé. Forcément le plus grand, soutenu par une ribambelle de frères et sœurs ; autant ils étaient solidaires entre eux, autant ils étaient assujettis à l’esprit tribal car pour beaucoup l’exode rural a poussé les parents à s’entasser dans ses minuscules logements qu’ils qualifiaient entre eux de boîtes d’allumettes.
Qu’importe, ils étaient de jeunes consciences soumises à l’insouciante indigence de leurs parents, analphabètes par hérédité pour la plupart d’entre eux. Que pouvaient-ils faire contre cette fatalité devenue séculairement légendaire, conjuguée à une misère endémique longtemps assimilée aux séquelles du colonialisme. Qu’à cela ne tienne du moment qu’ils allaient à l’école et qu’à l’indépendance les zaïms d’alors leur promettaient la huitième merveille du monde. L’Algérie allait devenir la plus belle et la plus prospère des nations issues des flancs de l’Histoire.
Les contradictions sociales ? Billevesées ! Le pays est uni et solidaire. Le socialisme aux contours mal définis à force de spécificité allait les propulser vers un devenir des plus florissants pensait-on, au sortir de la longue nuit coloniale. Désormais maîtres chez eux, ils allaient pouvoir s’affranchir pour toujours de l’insécurité alimentaire, apprivoiser la technologie et se pourvoir d’une culture dont ils été tôt sevrés… Hélas, il n’en fut rien… (A suivre)
Ammar Koroghli-Ayadi, auteur-avocat
Email : akoroghli@yahoo.fr