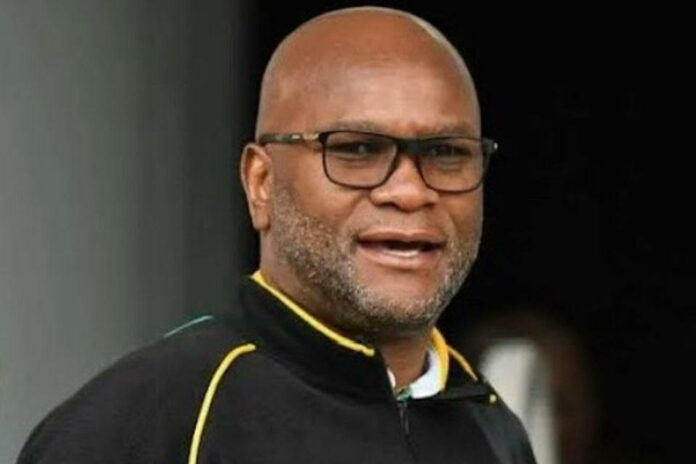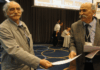La scène s’est déroulée discrètement à l’aéroport Charles-de-Gaulle, mais l’information a fait rapidement le tour des rédactions internationales : Halima Ben Ali, fille du président tunisien déchu Zine El-Abidine Ben Ali, a été interpellée mardi 30 septembre 2025 par la police française, à la demande des autorités tunisiennes.
Selon l’Agence France-Presse (AFP), citant une source judiciaire, l’arrestation a eu lieu alors que l’intéressée s’apprêtait à embarquer pour Dubaï. Elle est désormais placée sous la main de la justice française, qui doit examiner dès ce mercredi la requête tunisienne.
Halima Ben Ali doit ainsi comparaître devant le parquet général pour la notification de l’arrestation provisoire. Ensuite, l’affaire sera soumise à un conseiller judiciaire qui décidera soit de son placement sous écrou extraditionnel – première étape vers un éventuel transfert vers Tunis – soit d’un simple contrôle judiciaire sur le territoire français.
Une notice rouge Interpol
D’après son avocate, la fille cadette de Ben Ali est visée par une notice rouge Interpol émise par la Tunisie. Elle est soupçonnée d’implication dans des affaires de détournement de fonds publics et de corruption, dossiers qui remontent à l’époque où sa famille régnait sans partage sur le pays.
Halima Ben Ali, longtemps restée dans l’ombre contrairement à sa sœur Nesrine, s’était installée en France après la chute du régime, en janvier 2011. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes en Tunisie contre les proches de l’ancien chef d’État, accusés d’avoir bâti des fortunes colossales grâce à des passe-droits, des réseaux d’influence et des détournements massifs.
Les séquelles de l’ère Ben Ali
Quatorze ans après la révolution qui a mis fin au règne autoritaire de Zine El-Abidine Ben Ali, la justice tunisienne poursuit encore les ramifications de ce système. L’ex-président est mort en exil en Arabie Saoudite en 2019, mais ses héritiers continuent de faire l’objet de demandes d’extradition.
Ce nouvel épisode illustre la persistance de ce dossier hautement sensible. Si certains Tunisiens estiment qu’il est temps de tourner la page et de se concentrer sur les défis économiques et politiques actuels, d’autres insistent sur la nécessité d’obtenir des comptes et de récupérer les biens détournés.
Une décision judiciaire attendue
La justice française devra trancher : accéder à la demande tunisienne et engager la procédure d’extradition, ou au contraire estimer que les conditions légales ne sont pas réunies. De telles décisions prennent souvent du temps, car elles impliquent un examen minutieux des garanties offertes par le pays demandeur, en particulier sur le respect des droits fondamentaux.
En attendant, l’arrestation d’Halima Ben Ali marque une étape symbolique dans la longue traque des anciens dignitaires du régime. Elle rappelle aussi que la mémoire de la dictature et de la corruption reste vive en Tunisie, pays encore traversé par des tensions sociales et politiques profondes.
L’audience prévue ce mercredi à Paris pourrait ouvrir un nouveau feuilleton judiciaire, suivi de près tant en France qu’en Tunisie
Mourad Benyahia